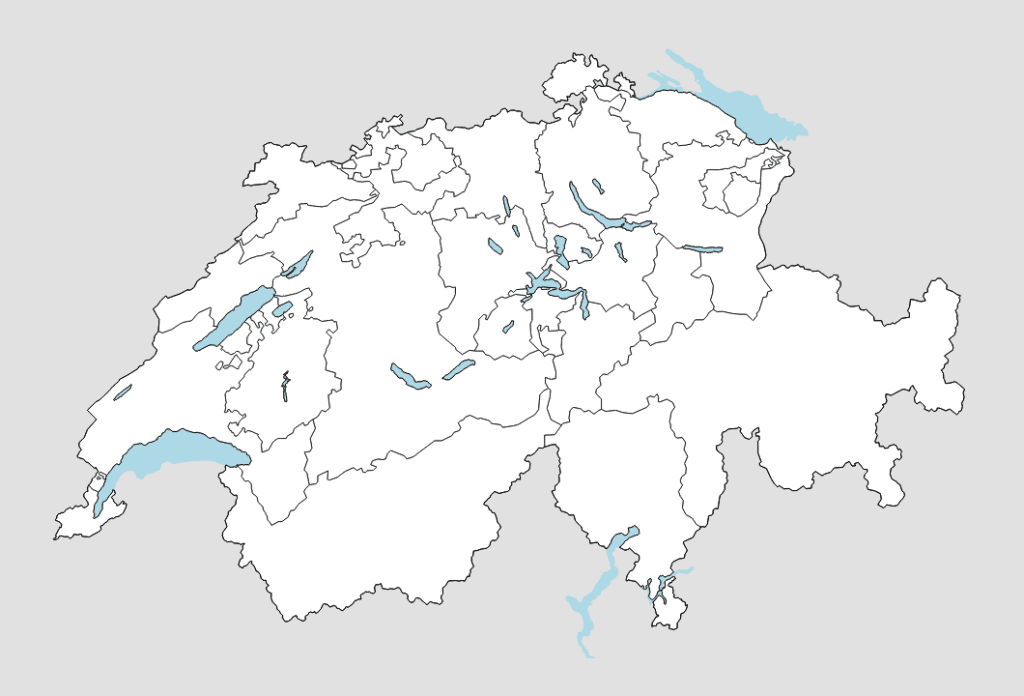M. Ermotti, CEO d’UBS, a raison de s’exprimer publiquement. Cette attitude est infiniment plus transparente que les pratiques du siècle passé, lorsque les grandes banques transmettaient leurs instructions aux politiciens bourgeois dans l’ombre des salons feutrés. Je ne me joindrai donc pas au chœur des protestations sur la forme.
Le fond est plus surprenant. A commencer par la conclusion de M. Ermotti, dans laquelle il reproche aux politiciens de ne pas regarder au-delà de l’horizon électoral, qui est – on le rappellera – de quatre ans. Non pas qu’il ait tort sur l’importance du long terme, dont les élus se préoccupent quand ils présentent aux citoyens des investissements à l’horizon 2030 ou 2040. Mais venant du monde de la finance, obsédé par la publication des résultats trimestriels – un horizon seize fois plus court que la législature politique –, cette critique surprend. Dans la même veine, M. Ermotti déplore la lenteur du processus politique, croyant y déceler une volonté insuffisante plutôt qu’un impératif démocratique. Ici, sa perspective est peut-être faussée par le fait que la Confédération a dû, plusieurs fois, adopter un rythme ultra-rapide et peu démocratique pour sauver… UBS.
Pour empoigner les problèmes, souvent réels, évoqués par M. Ermotti, il convient tout d’abord de bien les comprendre, ce qui nécessite un regard sur le passé. Pour ce faire, la stratégie du poisson rouge – c’est-à-dire l’amnésie – ne suffit pas.
Prenons l’exemple de la croissance et du durcissement des réglementations bancaires, que M. Ermotti déplore. Il en désigne sans hésiter les responsables, bien entendu l’Etat et la politique. Il oublie ainsi que la Suisse a été contrainte de se lancer dans une vague sans précédent de régulation bancaire, en raison précisément des catastrophes multiples générées par les banques. A commencer par la situation de quasi-cessation de paiements d’UBS en 2008, mais aussi et surtout à cause de l’incitation à la soustraction et à la fraude fiscales, pratiquée de manière industrielle pendant des décennies. Sans oublier le cocktail explosif induit par la mauvaise gestion du personnel et de la sécurité informatique. Et, last but not least, la politique de rémunération totalement outrancière, qui a conduit à l’acceptation compréhensible de l’initiative Minder.
Franchement, l’Etat se passerait bien de consacrer d’énormes ressources à la surveillance des banques. Mais l’expérience des dix dernières années montre qu’il est impossible de miser sur la confiance et l’autorégulation. Les banques sont capables de répéter en 2009 les erreurs coupables de 2007, même une fois que celles-ci ont été rendues publiques. La discussion sera nettement plus constructive lorsqu’elles auront quitté le mode amnésique du poisson rouge et comportemental du piranha.
S’agissant de l’isolement croissant de la Suisse, les craintes de M. Ermotti sont parfaitement justifiées. Il a raison: les citoyens devront revoter pour dire s’ils préfèrent appliquer aux Européens les contingents prévus par l’article constitutionnel de l’UDC ou sauver les accords bilatéraux. Mais sur ce point également, pour éviter de répéter les erreurs passées, il est impératif de comprendre comment ce texte néfaste a été accepté. Or, il est principalement le produit d’un parti politique, l’UDC, que les banques n’ont cessé de soutenir, enthousiasmées par la politique ultralibérale prônée par M. Blocher et ses consorts. Il est également le fruit d’une rhétorique nationaliste largement attisée par les banques, pour ralentir l’agonie du secret bancaire, présenté comme «une valeur humaniste menacée par le reste du monde». Enfin, si la Suisse n’a pas accès au marché européen des services financiers, c’est avant tout parce que, pendant des années, les banques se sont opposées à l’intégration de ce domaine dans les accords bilatéraux, par crainte d’une limitation du secret bancaire. Enfin, ce sont également les banquiers qui ont misé sur le mauvais cheval en préconisant l’impôt libératoire à la source (Rubik), alors que certaines forces, dont le PSS, avertissaient depuis longtemps que l’échange automatique d’informations serait le seul standard international reconnu. Cette tentative de diversion a fait perdre un temps précieux à la Suisse qui, le dos au mur, n’a plus pu obtenir l’accès au marché européen en contrepartie de l’échange automatique d’informations.
Le problème crucial de l’isolement de la Suisse ne se résoudra pas sans affronter les forces politiques qui le préconisent. La plus importante contribution que pourrait apporter M. Ermotti à ce combat vital consisterait à stopper tout soutien à l’UDC, direct ou indirect. En particulier, rien ne l’empêche de dénoncer le nationalisme, au lieu de l’alimenter en répétant dans son texte le vieux poncif affirmant que les autres pays sont peu performants.
Les conseils fiscaux de M. Ermotti dénotent eux aussi une déficience dans la perception des temporalités. Face au choc conjoncturel déclenché par la BNS, la baisse de l’imposition du bénéfice des entreprises ne sert à rien, car une entreprise en difficulté ne fait pas de bénéfice et ne paie de ce fait pas d’impôt. M. Ermotti est bien placé pour le savoir, puisque UBS ne paie plus d’impôt sur le bénéfice à la Ville de Zurich, en raison de l’ampleur des pertes accumulées par cet établissement depuis sept ans.
En outre, l’expérience de ces dix dernières années montre le danger majeur que représente l’insuffisance des ressources fiscales: la crise de la dette en Europe n’est pas seulement la conséquence du sauvetage des banques par les Etats. Elle s’explique aussi par une politique fiscale combinant négligence et cadeaux clientélistes.
Bref, je remercie M. Ermotti pour sa contribution au débat et je me permets de lui donner, à mon tour, un petit conseil: si UBS remplaçait la logique de maximisation du profit à court terme par celle de la responsabilité à long terme, son établissement, le reste de la place financière et le pays auraient tout à y gagner.